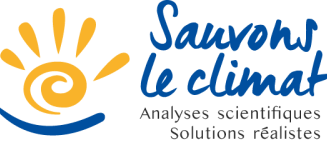Les engagements européens sont-ils réalistes ?
À l’approche de la COP30, 10 longues années après les accords de Paris, les émissions de gaz à effet de serre mondiales n’en finissent pas d’augmenter !
Las ! Le monde est occupé ailleurs ! Des humeurs de Trump à la guerre en Ukraine et aux morts en Palestine, des déficits abyssaux aux gouvernements éphémères, les Français comme les autres semblent lâcher l’affaire.
C’est dans ce contexte que, soucieux de ne pas arriver les mains vides à Belém pour la COP30, les ministres de l’environnement européens ont fini par trouver un accord au petit matin de ce 5 novembre 2025. L’idée soutenue depuis des semaines par Laurence Tubiana, membre du Haut Conseil pour le Climat est que c’est en affichant des objectifs ambitieux lors de la COP30 que l’Union Européenne pourra entraîner le reste du monde. Pour que l’Europe soit « sérieuse », il fallait, selon elle, endosser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de - 72,5 % en 2035 et - 90 % en 2040.
L’accord approuvé par une majorité qualifiée des pays européens est le suivant : une réduction de - 66,25 % (ces 0,25 % qui ont dû être âprement discutés !) à - 72,5 % des émissions en 2035 et - 90 % en 2040, tout en laissant la possibilité d’acheter 5 % de crédits carbone internationaux. La Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie ont voté contre cet accord, la Belgique et la Slovaquie se sont abstenues, la France comme les autres pays a voté pour. Certaines ONG, du WWF au Réseau Action Climat fulminent, dénonçant le renoncement qui consisterait à ramener de 90 % à 85 % l’effort requis grâce à ces crédits carbone monnayables.
Pour l’Union Européenne, qui ne va très certainement pas tenir l’objectif fixé de - 55 % à l’échéance 2030 devenu trop proche pour que des doutes subsistent, il s’agit donc de se projeter au-delà, en 2035 ou 2040, en affichant des ambitions toujours plus illusoires.
Cet objectif européen de - 90 %, bien qu’il soit parfaitement irréaliste, est celui qui a été défendu par le Haut Conseil pour le Climat dans un avis rendu le 5 septembre 2025 : « Objectif climatique européen 2040 et COP 30 : une proposition de la France menace l’Accord de Paris. »
Invité sur une radio, l’un des membres éminents du HCC, le Président du médiatique think tank Le Shift Project, Jean-Marc Jancovici, plus lucide, peut-être, que sa collègue Laurence Tubiana, s’est hasardé à défendre la position du HCC avec une argumentation surprenante : « On ne va pas tenir l’objectif mais ce n’est pas grave. Pour aller sur la Lune, c’est bien de viser les étoiles ! ».
La logique consistant à imaginer qu’il serait pertinent de viser très haut et de s’engager collectivement sur des objectifs inatteignables pour obtenir un peu conduit malheureusement à des impasses :
- Sur le plan de l’engagement citoyen : alors que le « backlash » écologique est de plus en plus évoqué, constater année après année que les objectifs qui auront nécessité des efforts importants sont loin d’être atteints ne peut que conduire à une grande frustration des citoyens et probablement l’abandon des ambitions climatiques.
- Sur le plan politique : ce serait donner des arguments en or à tous ceux qui affirment que les efforts demandés pour l’écologie sont démesurés et injustifiés.
- Sur le plan du droit : engager la signature du pays sur des objectifs irréalistes l’expose à la multiplication d’actions juridiques qui peuvent conduire à des condamnations financièrement et moralement douloureuses.
- Sur le plan stratégique : le choix des bons outils à mettre en œuvre et le rythme de leur déploiement dépend du choix de la trajectoire envisagée. Les choix technologiques justes sont ceux qui conduisent à une trajectoire réaliste.
Fixer des objectifs raisonnables et dûment étayés est la seule option pour déployer les outils optimaux avec un effort acceptable. L’ambition est certainement nécessaire, le déni conduit à des impasses.
Pour définir des cibles raisonnables pour 2035 ou 2040, il convient de bien comprendre la dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’œuvre depuis une décennie, comprendre les ressorts de chaque baisse d’émission et le potentiel réaliste de celles à venir.
Quelle a été la baisse des émissions depuis 10 ans en Europe ?
Si on concentre l’analyse sur les émissions de gaz carbonique (l’étude du méthane ou du protoxyde d’azote donnerait des résultats similaires) par secteur entre 2014 (juste avant les accords de Paris) et 2024, on constate que la réduction des émissions provient à 78% du secteur de la production d’électricité et à 10 % du bâtiment (Base de données EDGAR). Les émissions liées à la production d’électricité ont donc été très rapides en 10 ans alors que les autres secteurs se décarbonent à un rythme bien plus lent, le secteur du transport voyant même ses émissions augmenter.

Concernant la répartition par pays, la réduction des émissions liées à la production d’électricité est pour presque la moitié le fait de l’Allemagne et du Royaume Uni.

La baisse des émissions peut-elle se poursuivre au même rythme ?
La réduction de presque 700 MtCO2 entre 2014 et 2024 est importante mais l’atteinte de l’objectif de - 55 % en 2030 par rapport à 1990 nécessiterait environ 780 Mt de réduction supplémentaire. Réussir en 6 ans un peu plus que ce qui a été fait en 10 ans est ambitieux mais pourrait paraître atteignable. Il convient néanmoins de bien analyser les ressorts mis en jeu dans la décarbonation au cours des dernières années pour juger de l’avenir.
La réduction des émissions liées à la production d’électricité a été permise par la substitution massive du charbon par le gaz fossile d’une part et par la substitution d’électricité fossile par des énergies renouvelables. Mais cette réduction va inévitablement ralentir dans les prochaines années pour au moins 3 raisons :
- La part des émissions liées à la production d’électricité (EU27 et UK) est passée en 10 ans de 34 à 23 %.
Le plus facile a été fait en matière d’électricité. On peut au passage noter que lorsque l’électricité est décarbonée comme c’est le cas en France, il y a peu de potentiel de réduction. Les émissions de l’Allemagne pour la production électrique restent près de 8 fois celles de la France quand bien même la réduction en 10 ans a été 10 fois moindre en France qu’en Allemagne ! Exiger des réductions identiques de pays partant d’un point de départ si différent n’a aucun sens. C’est malheureusement souvent mis en avant pour discréditer les efforts de la France ! Quoi qu’il en soit, ce sont bien les autres secteurs qui devront devenir pourvoyeurs de réduction et cela s’est avéré historiquement plus lent et plus difficile.
- La question des prix négatifs de l’électricité va devenir prépondérante.

Si le nombre d’heures pendant lesquelles les prix du marché de l’électricité sont devenus nul ou négatifs est longtemps resté contenu à quelques heures par année lors de certains jours fériés, le phénomène a progressé massivement depuis 2023. En 2024, l’écrêtement de la production solaire est devenu massif de mai à août alors qu’il était rarissime en 2022.
L’ajout à marche forcée de capacité solaire en France comme chez nos voisins ne peut que conduire à la pérennité de prix de l’électricité nuls ou négatifs du 1er mai au 31 août entre 10h et 17h avec pour conséquence l’écrêtement de la production solaire. Cela signifie qu’un tiers de la production annuelle des nouvelles capacités installées pourrait simplement être perdu. Cette perte pèsera sur les comptes des investisseurs ou les dépenses publiques lorsque des mécanismes de compensation pour renoncement à la production sont mis en œuvre.
Au-delà de la rentabilité financière des projets c’est aussi le bilan carbone du kWh solaire qui sera dégradé par une production réduite au cours de la vie du panneau tant que le bilan carbone de sa fabrication principalement chinoise à ce jour restera élevé.
Dans ce contexte, il est probable que le rythme d’augmentation des capacités solaire sera revu à la baisse (renoncement à des projets) et que son impact sur la décarbonation sera moindre (production utile réduite).
- Le coût des énergies renouvelables baisse désormais moins rapidement.
Enfin, l’écrêtement massif de la production renouvelable intermittente s’accompagne d’un ralentissement de la baisse des coûts totaux. Pour les panneaux solaires, par exemple, on constate que la réduction des coûts se produit moins rapidement que dans les années 2010.

En France, les montants auxquels le kWh est attribué lors des appels d’offre organisés par la CRE ne baissent plus, au contraire.

Le remplacement facile d’énergies fossile par les énergies renouvelables ne va pas conduire à des réductions aussi favorables des émissions de gaz carbonique qu’elles l’ont été depuis 10 ans. Du travail de fond sur l’adaptation de la demande et le stockage de l’électricité sera nécessaire pour obtenir des résultats significatifs. Malgré ces efforts, ceux-ci seront d’autant moins efficaces que le potentiel de réduction lié à la production d’électricité sera réduit. Les fruits mûrs ont déjà été récoltés.
C’est donc bien dans les autres secteurs qu’il faudra aller chercher les réductions d’émissions à venir. Elles se poursuivent à rythme lent dans le bâtiment, l’industrie et les procédés industriels. Elles restent à venir dans le domaine du transport. Le secteur est prometteur mais les résultats y seront lents comme sera lent le renouvellement du parc automobile et les flottes de transport. Il y aura des résultats, probablement peu avant 2030. Il faudra mettre en œuvre des politiques résolument engagées pour obtenir des résultats d’ici 2035 ou 2040.
En conclusion
Pour l’UE (27) et le Royaume Uni, si la baisse des émissions de CO2 a été significative en 10 ans, depuis la signature des Accords de Paris, il s’agit principalement de baisse des émissions induites par la production d’électricité (- 539 Mt soit - 46 %), alors que l’ensemble des autres sources regroupant le bâtiment, l’industrie et le transport ont baissé beaucoup plus lentement.
Si on peut espérer un regain d’efficacité dans les transports, il est en revanche peu plausible que la production d’électricité continue de se décarboner au même rythme. On peut sans grand risque prendre le pari que la réduction de 55 % des émissions en 2030 par rapport à 1990 sera très loin d’être atteinte ! Dans ce contexte, est-il raisonnable de surenchérir quant à la fixation d’objectifs extravagants pour 2035 ou 2040 ?
Il nous paraît plus efficace de regarder en face la réalité et les données afin de tenir les objectifs ambitieux mais réalistes qui auront été fixés en mettant en œuvre les moyens concrets qui conduiront à un monde où l’atténuation aura été suffisante pour que l’adaptation reste possible.
Les justes solutions ne seront trouvées qu’à la condition impérative de dépasser les approches dogmatiques et partisanes en faveur d’une technologie ou d’une autre pour rechercher les solutions optimales. Parce qu’il est possible de rester idéaliste sans être naïf, il faudra déjouer les tentatives des lobbys qui cherchent à instrumentaliser la fixation d’objectifs ou à ignorer les réalités au profit des industries qu’ils soutiennent.
Pour les militants anti-nucléaires et peut-être pour la Commission Européenne, prétendre atteindre une réduction de 90 % des émissions en 2040 alors qu’une capacité limitée de nouveau nucléaire aura pu être déployée à cette date, c’est suggérer, à tort, l’idée que le rôle de l’énergie nucléaire ne pourra être que marginal. Forts de cet objectif contraignant, ils se feront forts d’exiger le développement massif et à tout prix de parcs éoliens et solaires. Y compris en assignant à des pays comme la France des objectifs excessifs contraires à ses intérêts économiques.
A contrario, certains militants anti-renouvelables font mine d’ignorer l’importance des énergies renouvelables dans la décarbonation de l’électricité (citons l’exemple du Royaume-Uni qui se rapproche de la France en niveau d’émission par habitant grâce au développement de l’éolien en mer) pour revendiquer un moratoire sur les énergies renouvelables intermittentes qui compromettrait les ambitions climatiques de long terme.
Rechercher un mix optimum entre les différentes énergies décarbonées, prenant en compte tous les coûts et toutes leurs spécificités, de manière objective et sans esprit partisan, voilà qui permettra à l’Europe de préserver sa compétitivité économique tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. C’est par une vision de long terme que l’on peut définir des objectifs annuels raisonnables. Aucune industrie, qu’elle soit nucléaire, éolienne ou solaire ne gagne à subir des « stop and go » délétères. Toutes ces énergies décarbonées sont capitalistiques et nécessiteront d’une manière ou d’une autre des garanties de rémunération. L’Union Européenne doit en être le garant.
On connaît le conte d’Andersen qui narre l’histoire de ce roi abusé par des tisserands peu scrupuleux prétendant avoir confectionné un costume fort élégant que les sots ne pouvaient pas voir. Une fois revêtu de l’étoffe remarquable, le roi comme ses courtisans prétendirent donc, soucieux de ne pas paraitre stupides, que le costume était superbe, les approbations unanimes des uns et des autres renforçant l’impératif pour chacun de s’aligner sur l’enthousiasme général. Il fallut l’innocence d’un enfant pour affirmer l’évidence que tous avaient constatée sans pouvoir oser la dire : que le roi n’avait pas de vêtements.
Il fallut de même, toute la notoriété du célèbre économiste de l’énergie, Vaclav Smil pour publier en mai 2024 une étude étayée « Halfway between Kyoto and 2050 Zero carbon is a very unlikely outcome ». Une version française a été publiée en 2025 sous la forme d’un petit livre largement commenté : « 2050 pourquoi un monde sans carbone est presque impossible ? » Vaclav Smil y explique ce que beaucoup savent mais n’osent dire, que l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 est probablement impossible.
Les objectifs européens tels qu’ils ont été fixés ce 5 novembre 2025 et seront probablement approuvés par le parlement européen sont illusoires. Défenseurs du climat, nous ne nous en réjouissons pas mais appelons seulement à un minimum de clairvoyance. Alors que le gouvernement corseté par la communication politique et des engagements européens inconséquents propose une Programmation Pluriannuelle de l’Énergie irréaliste, lorsque le Haut Conseil pour le Climat, qui devrait être le garant du succès de la politique énergétique française se hasarde à soutenir des trajectoires qu’il sait insoutenables, il est indispensable que des ONG résolument engagées pour la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre contribuent à étayer un chemin ambitieux et plausible.
Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on annonce mais ce que l’on fait !
Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat