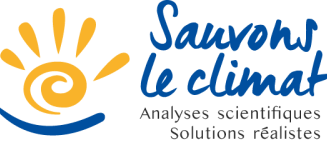Des émissions de GES françaises loin des objectifs de l’UE
En cet automne 2025, l’Europe est à un tournant de son histoire concernant ses objectifs de décarbonation. En effet, plusieurs pays, dont la France, mais aussi l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et d’autres ont, dans un premier temps, remis formellement en cause l’objectif européen de réduction de 90 % (par rapport à 1990) des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2040. Ce chiffre, proposé en février par la Commission européenne, visait à guider l’Union européenne vers la neutralité climatique à l’horizon 2050. Explications.
1 – La réalité : évolution des émissions de GES françaises à ce jour
La figure 1 ci-dessous (source : CITEPA) récapitule les émissions de GES depuis 1990 :

Cette première figure met en évidence une baisse lente des émissions entre 2005 (≈ 550 Mt) et 2024 (≈ 369 Mt, valeur définitive CITEPA) soit une baisse de ≈ 181 Mt en 19 ans et une baisse annuelle moyenne de ≈ 9,5 Mt/an.
La figure 2 ci-après (source : CITEPA également) donne une vision plus précise des émissions entre 2015 et 2024 :

Cette figure fait apparaître une baisse des émissions plus marquée entre 2017 (≈ 459 Mt) et 2024 (≈ 369 Mt, valeur définitive CITEPA) soit un baisse de ≈ 90 Mt en 7 ans et une baisse annuelle moyenne de ≈ 12,9 Mt/an. Cette accélération des baisses depuis 2017 doit cependant être nuancée compte tenu de la baisse exceptionnelle de ≈ 40 Mt pour la seule année 2020, due aux conséquences du Covid sur l’activité économique du pays.
Plus inquiétant, dans son Bilan prévisionnel 2025, le CITEPA anticipe une très faible baisse des émissions cette année (≈ 3 Mt) après avoir constaté une stagnation au 1er semestre 2025 par rapport au 1er semestre 2024. Soit une prévision (à valider en 2026 mais d’ores et déjà robuste en ordre de grandeur) de ≈ 366 Mt pour 2025. Cette donnée amène la perspective de baisse des émissions entre 2017 et 2025 à ≈ 93 Mt en 8 ans, soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 11,6 Mt/an.
2 – Les objectifs de l’UE retenus ou proposés (rappel)
* Objectif 2030 : deux références successives existent : le « Fit for 55 » pour l’Europe, soit – 55 % par rapport à 1990, qui conduit à 545 x 0,45 ≈ 245 Mt et le RÈGLEMENT (UE) 2023/857 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2023 qui remplace l’objectif précédent pour la France à – 47,5 % par rapport à 2005, ce qui conduit à 550 x 0,525 ≈ 288 Mt. L’écart entre les deux objectifs est de 45 Mt et on notera au passage que la France n’a pratiquement pas réduit ses émissions entre 1990 et 2005, comme le montre d’ailleurs bien la figure 1.
* Objectif 2035 : à déterminer entre l’objectif 2030 et le futur objectif retenu pour 2040
* Objectif 2040 : – 90 % par rapport à 1990 proposé par la Commission, soit 545 x 0,10 ≈ 55 Mt contesté par plusieurs Etats membres dont la France
* Objectif 2050 : 0 (neutralité carbone)
Il est alors possible d’estimer les baisses annuelles moyennes d’émissions qui seraient nécessaires pour atteindre ces objectifs, en partant de la situation estimée pour la France fin 2025 :
* Pour atteindre l’objectif 2030 : selon l’objectif initial, la réduction aurait dû être de ≈ 366 Mt à 245 Mt soit de 121 Mt en 5 ans, soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 24,2 Mt/an. Selon l’objectif révisé elle est de ≈ 366 Mt à 288 Mt soit de 78 Mt en 5 ans, soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 15,6 Mt/an.
* Pour atteindre l’objectif 2040 : réduction de ≈ 366 Mt à 55 Mt soit de 311 Mt en 15 ans, soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 20,7 Mt/an
* Pour atteindre l’objectif 2050 : réduction de ≈ 366 Mt à 0 soit de 366 Mt en 25 ans, soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 14,6 Mt/an
Commentaires :
* Ces évaluations sont volontairement basées sur les valeurs nominales des émissions et non sur des variations en pourcentage d’une année sur l’autre, qui sont en apparence plus facilement parlantes mais introduisent des biais dans la mesure où le dénominateur pris en compte varie chaque année.
* Il s’agit d’évaluations simplifiées réalisées sur la base d’une décroissance supposée linéaire, qui ne prend notamment pas en compte le fait que les réductions des émissions ont probablement des rendements décroissants au fur et à mesure du temps, les réductions les plus faciles étant en principe réalisées en premier. Les résultats sont donc à considérer comme des ordres de grandeur.
* On y ajoutera deux variantes hypothétiques complémentaires pour en estimer les impacts sur les émissions annuelles moyennes :
° Variante 1 : Neutralité carbone retardée à 2055 : élimination de ≈ 366 Mt en 30 ans soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 12,2 Mt/an
° Variante 2 : Neutralité carbone retardée à 2060 : élimination de ≈ 366 Mt en 35 ans soit une baisse annuelle moyenne de ≈ 10,5 Mt/an
Ces résultats montrent que se donner un peu plus de temps (5 à 10 ans) pour atteindre la neutralité carbone réduit très sensiblement le rythme requis de baisse annuelle moyenne, jusqu’à des valeurs expérimentées ces dernières années. Ce point est discuté au § 4.
3 – Des écarts entre réalité et objectifs impossibles à combler…
Sur les bases ci-dessus, il apparait clairement que pour respecter l’objectif 2030 pour la France, il faudrait augmenter de ≈ 50 % le rythme de baisse annuelle des émissions moyennes de ces dernières années à partir du 1er janvier 2026 et pour respecter l’objectif proposé par la Commission de – 90 % en 2040, il faudrait pratiquement doubler ce rythme et ce toujours dès 2026. Pour mieux imager l’ampleur de ces baisses, il s’agirait de réaliser CHAQUE année plus de la moitié de la baisse de l’année du Covid. Est-ce réaliste ou plus exactement de l’ordre du possible ? D’évidence non, d’autant plus qu’après des résultats relativement favorables entre 2017 et 2024, ceux de 2025 ne sont pas de bon augure, ceci pour plusieurs raisons structurelles :
* Les baisses récemment observées, notamment en 2023 et 2024, ont été largement portées par le secteur de la production d’électricité, qui a atteint en 2024 un taux d’électricité décarbonée de 95 %. Ce taux s’est maintenu au 1er semestre 2025 (donnée RTE) et devrait continuer à se maintenir voire s’améliorer au 2ème semestre et dans les années à venir. Mais à ce niveau très élevé, le secteur est entré dans une zone de baisses incrémentales de ses émissions et il ne pourra donc contribuer que très marginalement aux futures baisses.
* Il en résulte que les futures baisses devront essentiellement reposer sur l’ensemble des autres secteurs de l’économie dont l’enjeu principal sera de s’électrifier en utilisant l’électricité décarbonée déjà disponible en abondance. Cet enjeu est majeur mais difficile à mettre en œuvre, l’électrification de ces autres secteurs étant actuellement à la peine pour plusieurs raisons qui cumulent leurs effets :
° L’envolée aberrante des prix de marché de l’électricité en 2022 et 2023 a laissé des traces profondes sur les comportements des consommateurs de toutes catégories et explique en partie, selon les analyses de RTE, la stagnation actuelle de la consommation. Et le prix de l’électricité est actuellement davantage plombé par les taxes que celui les énergies fossiles. Qu’on en juge :
- L’accise sur l’électricité est d’environ 36 €/MWh TTC (comprenant 20 % de TVA) pour les particuliers et d’environ 31€/MWh TTC pour la majorité des professionnels (hors électro-intensifs), soit environ deux fois plus élevée que l’accise sur le MWh de gaz !
- La charge du financement des CEE (Certificats d’économie d’énergie) est d’environ 11 €/MWh TTC sur le MWh d’électricité, soit là encore environ deux fois plus élevée que la charge sur le litre d’essence !
- Au total, pour les particuliers, l’électricité quasi-décarbonée est à peu près deux fois plus taxée à 36 + 11 = 47 €/MWh TTC que les énergies fossiles ! Signal totalement contreproductif pour la consommation d’électricité, alors qu’une politique cohérente de décarbonation de l’économie devrait affecter exclusivement ces taxes aux énergies fossiles. Comprenne qui pourra…
° L’électricité est en outre toujours défavorisée par rapport aux combustibles fossiles (fioul et gaz) dans l’habitat domestique et tertiaire du fait de son comptage en énergie primaire, qui multiplie artificiellement par 1,9 sa consommation réelle en énergie finale. Ce coefficient n’a plus aucune réalité, ni physique, ni économique (le consommateur paie des MWh d’énergie finale) avec une électricité décarbonée à 95 %. Il est devenu totalement absurde. Sa réduction cosmétique de 2,3 à 1,9 au cours de l’été 2025 alors qu’il aurait dû être ramené à 1, est une nouvelle occasion manquée par le gouvernement pour des raisons autres que rationnelles que l’on ne qualifiera pas ici, ceci en dépit des recommandations unanimes des académies et de nombreuses autres entités travaillant sur des bases scientifiques.
° L’autre facteur structurant qui freine l’électrification est sans conteste le coût très élevé des investissements à réaliser pour la mettre en œuvre, ceci dans tous les secteurs de l’économie, qu’il s’agisse des entreprises ou des particuliers. Enfin, la conjoncture économique et politique actuelle freine les investissements industriels et les initiatives des particuliers qui préfèrent faire des économies.
L’ensemble de ces raisons et quelques autres se cumulent de façon variable selon les secteurs :
° L’industrie tarde à s’électrifier et pire, la réindustrialisation souhaitée ne se fait pas. Au contraire, des usines ferment et lorsqu’elles le font c’est définitivement dans l’immense majorité des cas. La baisse des émissions dans ce secteur est donc un très mauvais signal pour l’économie et pour l’avenir, sachant que l’électrification du secteur industriel s’inscrit dans le temps long.
° La mobilité routière, secteur le plus émetteur de tous, ne réduit pas ses émissions suffisamment vite. En cause, des achats insuffisants de voitures électriques par les particuliers et les entreprises du fait notamment de leurs prix, mais aussi d’autres facteurs plus complexes. Et l’électrification des transports lourds, qui pèse beaucoup dans le total, n’en est qu’à ses tout débuts. Cette évolution s’inscrit aussi dans le temps long : il faut 12 à 15 ans pour renouveler complètement un parc automobile et les informations récentes indiquent que beaucoup d’utilisateurs conservent leurs véhicules anciens plus longtemps (12 ans en moyenne) avec un impact défavorable, les véhicules anciens étant plus émetteurs de CO2 et plus polluants que les véhicules récents. Les considérations financières sont majoritairement à l’origine de ces choix, les prix des voitures neuves, électriques ou pas, ayant fortement augmenté depuis quelques années. La solution à ce problème est connue : aider les consommateurs à renouveler leurs véhicules pour des VE. Mais les fréquents changements de ces aides, en montants et en modalités d’octroi, ont eu des effets négatifs sur les décisions d’achats, notamment suite à la baisse des aides entre 2024 et 2025.
° L’habitat domestique et tertiaire, autre secteur fortement émetteur, ne réduit pas non plus assez vite ses émissions. Plusieurs causes sont en jeu : d’abord des réglementations (RT2012 et RE2020) qui ont défavorisé de façon aberrante l’électricité par rapport aux énergies fossiles, fioul et gaz (voir ci-dessus). Conséquence, il a suffi que l’hiver 2025 soit un peu plus froid que l’hiver 2024 pour que les émissions de CO2 de l’habitat augmentent significativement au 1er semestre 2025 par rapport à 2024 et annulent les baisses de CO2 dans les autres secteurs, pour un résultat global stagnant selon le CITEPA ! Ce résultat traduit le poids élevé persistant des énergies fossiles dans ce secteur, aggravé par la difficulté et le coût des rénovations thermiques des bâtiments et l’insuffisante pénétration des pompes à chaleur, qui constitue pourtant la technologie de base la plus efficace pour l’avenir. Son déploiement, après de bons débuts voici quelques années, a connu une forte baisse en 2024, notamment du fait de coûts d’investissements nettement plus importants que dans le gaz et d’une réduction des aides à leur achat. Cette baisse des ventes de pompes à chaleur a aussi eu des conséquences majeures sur les industriels français, allant jusqu’à des faillites pour certains. Enfin, les changements incessants des aides (MaPrimeRénov pour l’habitat) durant ces dernières années avec une valse des aides entre rénovations globales et rénovations ponctuelles ont désorienté les consommateurs et les ont conduits à l’attentisme et par conséquent à l’inaction.
° L’agriculture, secteur atypique qui émet très peu de CO2 mais essentiellement d’autres gaz réchauffants (méthane et protoxyde d’azote) est quant à elle dans une situation économique globalement très difficile et précaire, voire dans la survie pour certaines productions, ce qui ne va certainement pas l’inciter à donner la priorité aux baisses d’émissions de GES.
4 – Quelles suites et conséquences ?
Il résulte de ce qui précède, si l’on veut bien regarder la réalité en face, que les perspectives de baisses importantes d’émissions de GES dans les quelques années à venir apparaissent à la fois comme très difficiles à atteindre et très fortement incertaines, rendant de facto impossible le respect de l’objectif 2030 de l’UE. Quant à l’objectif de 2040, il est contesté par plusieurs pays, ainsi qu’indirectement celui de 2035 qui dépendra de l’objectif de 2040 finalement retenu. On ne peut alors raisonnablement exclure que la non-atteinte de ces objectifs induise un retard de quelques années sur la date d’atteinte de la neutralité carbone de la France.
Cette situation est-elle si étonnante et ses conséquences sont-elles si graves ?
* Cette situation est-elle si étonnante ? Non ! Les objectifs de l’UE, fixés dans le but légitime de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C selon l’Accord de Paris (cap qui n’est plus d’actualité car il devrait malheureusement être franchi courant 2029 selon le service européen Copernicus), l’ont été sans aucune étude d’impact sérieuse : l’UE a adopté une planification technocratique de nature incantatoire, voire moralisatrice (l’Europe se voulant le continent le plus « vertueux du monde »…) sans aucun lien avec les réalités scientifiques, technologiques, économiques, sociales et sociétales. Mais la réalité finit toujours par s’imposer. On y est en partie avec la remise en cause de l’objectif 2040 par plusieurs pays, même si la prise de conscience de cette réalité est encore loin d’être générale et reconnue, y compris probablement aussi pour des raisons d’affichage politique qui requièrent du courage (« le premier qui le dira, il doit être exécuté » comme le chantait Guy Béart dans « La Vérité »).
Persister dans l’illusion n’aurait pourtant aucun sens et conduirait à prendre des décisions non optimales et à gaspiller des ressources rares, financières notamment, dans un contexte fortement dégradé par l’endettement du pays. Ce dernier constitue d’évidence une contrainte très forte, qui ne signifie évidemment pas qu’il faudrait arrêter les actions qui contribuent de façon efficace et optimale à la décarbonation de l’économie, d’autant plus quand elles ont pour effet financier bénéfique de réduire les très coûteuses importations d’hydrocarbures.
* Ses conséquences sont-elles si graves ? Non, également, pour des raisons objectives, même si elles sont contraires à la bien-pensance :
° Il faut remettre la France dans le contexte mondial. Trois pays émettent à eux-seuls pratiquement la moitié des GES mondiaux : la Chine (≈ 30 %), les Etats-Unis (plus de 11 %) et l’Inde (plus de 8 %). De plus, la Chine a annoncé de longue date sa neutralité carbone pour 2060 et vient de la confirmer. Ses annonces ont une certaine crédibilité dans la mesure où elle engage et réalise effectivement des programmes nucléaires, hydrauliques, éoliens et photovoltaïques de très grande ampleur pour remplacer à terme son charbon. Quant aux perspectives de neutralité carbone des Etats-Unis, elles sont actuellement rejetées et leur avenir est indéterminé. Enfin, l’Inde, pays qui devrait dépasser 1,6 milliard d’habitants en 2050, ne peut que susciter des interrogations fortes concernant sa décarbonation en 2050-2060.
Dans ce contexte, la « petite » France émet un peu moins de 1 % des GES mondiaux, soit 50 fois moins que ces trois mastodontes réunis. L’arithmétique permet de conclure qu’un retard de 5 à 10 ans de sa neutralité carbone aurait une effet réel négligeable sur le réchauffement de la planète.
° Il faut aussi la remettre dans le contexte européen. Si l’on considère les émissions par habitant dans les 27 pays de l’UE (source : touteleurope.eu), la France arrive en 2024 au 5ème rang des pays les moins émetteurs avec 5,7 t/ha, après la Suède (1ère avec 5,1 t/ha), Malte, le Portugal et la Roumanie ; la moyenne de l’UE se situe à 7,1 t/ha et le pays le plus émetteur, le Luxembourg, à 12,7 t/ha, la Pologne à 9,3 t/ha et l’Allemagne à 8,2 t/ha.
5 – Pour résumer et conclure
La France n’a pas à battre sa coulpe pour sa performance climatique actuelle, due en très grande partie à son électricité largement décarbonée, atout exceptionnel parmi les pays développés de taille notable. Mais comme déjà souligné plus haut, le plus difficile reste à faire : l’électricité abondante déjà décarbonée à 95 % a une marge résiduelle de progrès très réduite et l’avenir de la décarbonation du pays repose dorénavant sur tous les autres secteurs de l’économie, en premier lieu les plus émetteurs, la mobilité terrestre et l’habitat, qui sont aussi ceux qui touchent directement les citoyens-consommateurs. Cela à condition que l’électricité se substitue aux énergies fossiles le plus rapidement possible. Mais au moins trois freins déjà cités ralentissent cette substitution :
* Le coût initial très élevé de la transition vers l’électrification de l’économie, qui s’ajoute, notamment pour les citoyens-consommateurs, au « coût pour vivre » dans une économie encore largement soumise aux énergies fossiles qu’il faut toujours payer en attendant leur effacement. Ce processus n’a absolument pas été anticipé, ni au niveau européen, ni au niveau national du fait de l’absence d’études d’impact préalables. Et le fait qu’un processus aussi complexe ne peut s’inscrire que dans un temps long suffisant ne l’a pas été davantage. Ces carences prospectives ont conduit à des objectifs décidés au « doigt mouillé » fatalement irréalistes.
* Une taxation de l’électricité décarbonée, dont on veut promouvoir l’usage, plus lourde que celle des énergies fossiles, dont on veut réduire la consommation ! Bienvenue en absurdie…
* Des politique d’aides à la mobilité électrique et à la rénovation de l’habitat rendues peu lisibles par leur complexité et leur inconstance, qui ont déboussolé et dissuadé d’agir leurs bénéficiaires potentiels.
Tout cela met en évidence une gouvernance politique globale défaillante et sans vision prospective sérieuse à long terme, qui a prévalu jusqu’à présent à la fois en Europe et en France, qui l’a servilement accompagnée et validée au fil du temps, aboutissant à un déni de réalité généralisé.
Ce déni de réalité ne semble pas près de disparaître et a donné lieu au niveau européen à un exercice sémantique de haut vol après une nuit de négociations, juste avant l’ouverture de la COP 30 qui se tient au Brésil. Comme il était hors de question que l’Europe arrive à la COP sans un objectif commun « politiquement correct », le Conseil européen des ministres de l’environnement des Etats membres a finalement réussi à se mettre d’accord in-extremis sur l’objectif proposé par la Commission d’une réduction des émissions de GES de 90 % en 2040 par rapport à 1990. Mais en… l’assortissant de « flexibilités », terme fourre-tout à géométrie variable qui inclut par exemple des achats de crédits carbone internationaux, ce qui a permis d’obtenir un consensus général. Et pour montrer que l’Europe est décidément un « bon élève », des objectifs intermédiaires de réduction en 2035 se situant « entre – 66,25 % et – 72,5 % par rapport à 1990 » selon les pays, ont également été convenus. On appréciera au passage la précision de ces objectifs…
Malheureusement, cette fuite en avant confirmée dans le déni de réalité ne changera rien à la dure réalité qui finira par s’imposer de façon aveuglante et brutale, ceci probablement dès avant 2030, c’est-à-dire demain. Il serait pourtant urgent de regarder enfin cette dernière en face pour mener dès que possible une politique réaliste loin des illusions, seule à même de conduire à des décisions les plus efficaces possibles pour réduire concrètement les émissions de GES.
Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat