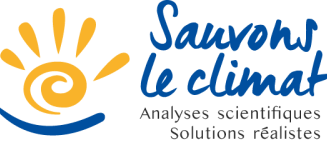C’est par l’affirmation : Débats sur l'énergie - Démêler le vrai du faux que la CRE (Commission de régulation de l’énergie) prétend apporter la bonne parole, en la présentant implicitement comme porteuse de « VÉRITÉ ». Tout n’est pas faux, mais ce l’est dans plusieurs cas, complètement ou à moitié, ce qui revient au même.
Cela soulève une interrogation déontologique majeure concernant l’attitude d’une Autorité Administrative Indépendante (AAI), financée sur deniers publics, à laquelle l’État a délégué une part de ses prérogatives ; et jette en conséquence la suspicion sur l’ensemble de la démarche et du document.
Trois exemples fortement critiquables sont analysés ci-dessous
(les affirmations de la CRE sont reproduites en italique).
- « Les EnR sont-elles responsables de l’évolution de la facture ? FAUX !»
« Le soutien des énergies renouvelables par l’État n’est à ce jour pas directement répercuté sur la facture.
L’augmentation de 20 % hors inflation des factures sur les dix dernières années est imputable à un ensemble de facteurs. Les factures d’électricité se décomposent en 3 parties :
- la fourniture en électricité (qui représente environ 40 % de la facture)
- le tarif d’utilisation des réseaux (environ 29 %)
- les taxes (environ 31 %).
Cette répartition a évolué au cours du temps, la part fourniture en électricité ayant notamment augmenté pendant la crise de 2022-2023 (crise d’approvisionnement en gaz et baisse de la production nucléaire due à la corrosion sous contrainte).
Sur la partie fourniture en électricité, les EnR ont plutôt tendance à faire baisser les prix de gros compte tenu de leur coût marginal faible ».
Avis de Sauvons le climat : il y a deux sujets différents dans cette fausse affirmation :
* « Le soutien des énergies renouvelables par l’État n’est à ce jour pas directement répercuté sur la facture ».
Tout réside dans le mot « directement » qui masque la réalité. Formellement, il est exact que le coût des EnRi n’apparaît pas directement dans les factures d’électricité. Il est payé par le budget de l’État. Mais le budget de l’État est financé par le contribuable.
C’est donc un tour de passe-passe d’illusionniste, ces coûts sont bien payés par la collectivité, celle des contribuables-consommateurs d’électricité, dont une grande partie sont les mêmes ! Et au passage, l’État n’oublie malgré tout pas de prélever une accise de 29,98 €/MWh HT sur le tarif d’électricité domestique (valeur depuis le 1er août 2025), assortie d’une TVA de 20 % qui porte la somme prélevée à 34,78 à €/MWh TTC. Mais cela étant caché dans la rubrique « taxes », la CRE n’en dit mot. Omission non fortuite …
* « Sur la partie fourniture en électricité, les EnR ont plutôt tendance à faire baisser les prix de gros compte tenu de leur coût marginal faible ».
On est là dans une tromperie intellectuelle doublée d’une contre-vérité flagrante :
- La tromperie réside dans le fait que les contribuables-consommateurs ne paient pas le « coût marginal faible » des EnRi (EnR électriques variables et intermittentes d’origine éolienne ou solaire photovoltaïque) mais au contraire leur coût complet, très supérieur et largement subventionné par les contribuables comme rappelé ci-dessous ;
- La contre-vérité réside dans le fait que la CRE sait parfaitement que les premières EnRi ont été achetées à leurs producteurs à des prix exorbitants. Ces prix n’ont ensuite baissé que très progressivement et lentement. Ces premiers achats et les suivants pendant plusieurs années continuent à peser lourdement sur les factures, eu égard à la durée des contrats souscrits (20 ans pour la plupart).
Les prix actuels des EnRi ont certes significativement baissé mais pour certaines technologies seulement, surtout pour le photovoltaïque, mais leur soutien financier moyen reste très élevé. Quelques chiffres issus des documents officiels de la CRE le montrent :
- En 2024, ce soutien s’est élevé à ≈ 2,9 Mds € pour une production de l’ordre de ≈ 69 TWh. Soit un soutien moyen de ≈ 42 €/MWh ;
- Pour 2025, la CRE a ré-évalué (en juillet dernier) ce soutien prévisionnel à ≈ 6,2 Mds €. La production correspondante attendue n’est pas encore exactement connue, mais celle du 1er semestre 2025 l’est. Elle indique (source : RTE) une baisse de la production éolienne de ≈ 2,1 TWh et une hausse de la production solaire de 3,5 TWh, soit une augmentation nette de 1,4 TWh par rapport à 2024. La production globale de 2025 peut donc être estimée très approximativement dans ces conditions à environ ≈ 71 TWh.
Sur ces bases, le soutien moyen prévisionnel devrait atteindre environ ≈ 87 €/MWh, soit plus du double de celui de 2024 ! Cette augmentation est attribuée par la CRE à la baisse des prix de marché, ce qui au passage montre les aberrations de ce dernier : quand ses prix baissent, les contribuables consommateurs paient de facto plus cher leur électricité !
Ces chiffres appellent donc deux remarques : (1) ils contredisent clairement l’affirmation de la CRE selon laquelle « les EnR ont plutôt tendance à faire baisser les prix ». Et (2) ils montrent que le montant moyen du soutien d’une année sur l’autre est extrêmement variable, donc fortement imprévisible.
- Mais il y a plus : la CRE « oublie » opportunément de dire que ces moyens EnRi sont incapables d’assurer seuls la satisfaction de la demande : ils ont impérativement besoin d’appoints-secours par des moyens pilotables qui suppléent leurs variations ou manques de production ainsi que par des moyens de stockage-déstockage d’énergie pour stocker leurs excès de production et les déstocker lors de leurs manques de production. Or, ces moyens de stockage (nouvelles STEPs et surtout batteries, voire stockages d’hydrogène inter-saisonniers), sont très coûteux, sans parler de l’indispensable multiplication des réseaux de raccordement car ils sont spatialement très dispersés.
Il en résulte que les EnRi ne fournissent donc pas du tout le même service que les moyens pilotables et considérer isolément leur prix de production n’a donc strictement aucun sens économique : il faut en effet y ajouter les coûts indirects induits de tous les moyens palliatifs précités. Au total, ils ne font pas baisser les prix des MWh payés directement ou indirectement par les consommateurs-contribuables, ils les font monter !
La preuve en a été donnée par RTE dans son étude Futurs énergétiques 2050 qui utilise la seule méthode de calcul économique qui permet d’intégrer l’ensemble des coûts de toutes les composantes d’un système électrique : la méthode du coût moyen annualisé du système électrique. Il apparaît alors sans ambiguïté que les mix comportant le plus d’éolien et de PV produisent l’électricité la plus chère pour la collectivité, ce qui contredit totalement les affirmations de la CRE.
- « La France a-t-elle prévu d’investir 300 milliards d’euros pour développer les EnR ? FAUX !»
« Très concrètement, s’agissant des réseaux d’électricité, environ 100 Mds € d’investissements totaux sont annoncés par RTE (transport) et environ 90 Mds € par Enedis (distribution) jusqu’en 2040. L’essentiel de ces investissements vise la maintenance, le renouvellement des réseaux existants, le raccordement des consommateurs et des zones industrielles de décarbonation et l’adaptation au changement climatique.
Pour ce qui concerne le raccordement des énergies renouvelables :
- environ 18 Mds € d’investissements sont prévus pour les EnR terrestres, selon les gestionnaires de réseaux – ces raccordements sont en outre partiellement financés par les producteurs eux-mêmes ;
- environ 37 Mds € sont prévus d’ici 2040 pour l’éolien en mer au réseau de transport, la France ayant fait le choix de faire financer l’ensemble des raccordements au travers du TURPE.
Il est important de noter qu’il s’agit de prévisions, qui évolueront en fonction du rythme réel de développement des EnR en lien avec l’électrification de l’économie.
A ces coûts de raccordement s’ajoutent des coûts de renforcement du réseau qui sont en partie liés au développement des énergies renouvelables.
S’agissant du soutien public aux énergies renouvelables, les nouveaux engagements nécessaires à l’atteinte des objectifs sont estimés par la CRE à environ 50 Mds € d’ici 2060, dans un scénario de prix de marché médian.
En additionnant le coût pour les réseaux et le coût du soutien public aux énergies renouvelables électriques, on est donc très loin du chiffre de 300 milliards d’euros. En outre, ces investissements seront étalés sur plusieurs décennies ».
Avis de Sauvons le climat : il y a deux sujets très différents dans cette déclaration de la CRE : les coûts des réseaux supplémentaires indispensables aux EnRi et leurs soutiens publics.
1) Coûts des réseaux supplémentaires indispensables aux EnRi prévus à la PPE3.
La CRE cite les 37 Mds € dédiés aux seuls raccordements de l’éolien en mer, qui sont spécifiques et ne peuvent être noyés dans d’autres coûts. Ils sont donc incontestables. Mais aussi 18 Mds € dédiés aux raccordements des EnRi terrestres, qui concernent les deux réseaux, de transport et de distribution, ces dépenses pouvant facilement être noyées dans les autres coûts de réseaux. Si l’on fait l’hypothèse simplificatrice, en l’absence de précisions données par la CRE, que les deux réseaux se partageraient à peu près également les investissements, chacun d’eux investirait environ ≈ 9 Mds €, montant très faible pour ENEDIS au regard des 96 Mds € d’investissements totaux prévus (et non 90 comme indiqué ci-dessus dans le texte de la CRE).
Est-ce crédible ? Non ! C’est parfaitement incohérent avec ce qu’ENEDIS a écrit dans l’en-tête du chapitre 4 de ses éléments de prospective à horizon 2050 : « Le développement des énergies renouvelables raccordées au réseau de distribution sera le facteur le plus déterminant pour Enedis » en prévoyant que les besoins annuels à y consacrer pourraient aller de 1,5 à 8 Mds € par an selon la croissance et le scénario de développement des EnRi, soit une moyenne de près de 5 Mds€ par an. Avec ses 9 ou même 18 Mds € au total, la CRE est ici prise en flagrant-délit de sous-estimation majeure des besoins financiers d’ENEDIS : 10 ans d’investissements entre 2025 et 2035 représentent environ ≈ 50 Mds € en ordre de grandeur !
Tout laisse donc à penser que la réalité des coûts n’est pas de 37 + 18 = 55 Mds €, mais au minimum de 37 + ≈ 9 + ≈ 50 soit au total, environ ≈ 96 Mds € en ordre de grandeur ! On est là face à un soupçon de sous-estimation des coûts par la CRE d’un facteur proche du simple au double, incompréhensible et extrêmement problématique pour la crédibilité des affirmations de la CRE.
2) Soutien public aux énergies renouvelables électriques relatif aux EnRi prévus à la PPE3.
On peut lire : « les nouveaux engagements nécessaires à l’atteinte des objectifs sont estimés par la CRE à environ 50 Mds € d’ici 2060, dans un scénario de prix de marché médian ».
Un petit calcul permet d’éclairer cette affirmation : les nouveaux investissements EnRi prévus à la PPE3 pour 2035 représentent, selon la moyenne des fourchettes annoncées : + 16,5 GW d’éolien en mer ; + 19 GW d’éolien à terre ; + 50 GW de PV. Avec des facteurs de charge respectivement estimés à 38 %, 25 % et 14 %, la production annuelle de ces nouveaux moyens serait de l’ordre de ≈ 158 TWh/an. Sur les 25 ans qui séparent 2035 de 2060, cela ferait au total ≈ 3 950 TWh.
On peut alors en déduire que le soutien public moyen aux EnRi électriques de ces nouveaux moyens ressortirait à ≈ 12,6 €/MWh. Ce montant est-il crédible comparé aux ≈ 42 €/MWh de 2024 et aux ≈ 87 €/MWh de 2025 (voir ci-dessus) et à la très forte variabilité des résultats d’une année sur l’autre mise en évidence par ces deux années ? Il suffirait qu’il soit doublé à ≈ 25 €/MWh ou triplé à ≈ 38 €/MWh pour que le montant total du soutien public passe de 50 à respectivement 100 ou 150 Mds €… Or, les montants des soutiens publics qui existeront à l’horizon 2035 et au-delà sont totalement inconnus à ce jour. Mais leurs conséquences financières sont potentiellement colossales sur les dépenses globales à consentir ! On quitte là le domaine de la saine économie pour celui de la spéculation…
Enfin, un troisième poste majeur de dépenses est, comme déjà souligné plus haut, passé sous silence par la CRE : celui des investissements indispensables pour compenser la variabilité et l’intermittence des capacités d’EnRi prévues à la PPE, en particulier par des moyens de stockage-déstockage d’énergie très importants et très coûteux. Il est difficile d’en estimer les coûts précis à ce stade, mais ils pourraient atteindre plusieurs dizaines de Mds €.
En conclusion, entre omissions, volontaires ou non, chiffres incomplets ou très fortement sous-évalués et estimations qui relèvent davantage d’un pari que de véritables prévisions dans un avenir très incertain de prix de marché en 2035 et au-delà jusqu’en 2060 (!), les contre-arguments développés par la CRE ne peuvent en aucun cas convaincre. Ils soulèvent au contraire des questions majeures qui nécessiteraient des informations complémentaires et des analyses de risques approfondies concernant les objectifs de la PPE3.
- « Le black-out espagnol a été provoqué par un trop plein d’énergie solaire que le réseau n’a pas su absorber ? FAUX !»
« Le rapport publié par les autorités espagnoles conclut que la part des énergies renouvelables dans le mix espagnol n’a pas été la cause du black-out survenu le 28 avril dernier. Il fait état d’une conjonction de facteurs ayant entraîné un phénomène de tension haute, qui n’a pas pu être contrôlé par le réseau.
Par ailleurs, les conclusions des enquêtes techniques européennes seront publiées à l’automne 2025. Elles permettront d’apporter un éclairage supplémentaire ».
Avis de Sauvons le climat : le black-out espagnol est un phénomène multifactoriel d’une très grande complexité technique, que les meilleurs experts européens de l’ENTSO-E (organisme qui regroupe l’ensemble des gestionnaires de réseaux européens homologues de RTE) sont en train d’analyser. Ils ont été mandatés pour ce faire selon la réglementation européenne et ont un délai de 6 mois pour conclure. C’est dire que la démarche requiert un travail très complexe s’appuyant sur des expertises nombreuses et approfondies, à l’image de l’analyse d’un crash aérien : on en charge les experts en sécurité aéronautique qui détiennent la compétence, pas les gouvernements !
Se référer au rapport publié par les autorités espagnoles le lendemain ou le surlendemain de l’incident n’a donc aucun sens. Le gouvernement espagnol n’a aucune expertise dans le domaine (ce n’est pas son métier !) et a « conclu » sur des bases manifestement politiciennes qui semblent surtout avoir eu pour but de dégager sa propre responsabilité de « prescripteur-décideur » du mix électrique espagnol … et la faire porter au gestionnaire du réseau de transport espagnol.
Il est inquiétant de constater que la CRE, qui prétend dire le VRAI, s’appuie pour ce faire sur une base qui n’offre aucune garantie scientifique. Autant se référer aux réseaux sociaux …
*******
Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat